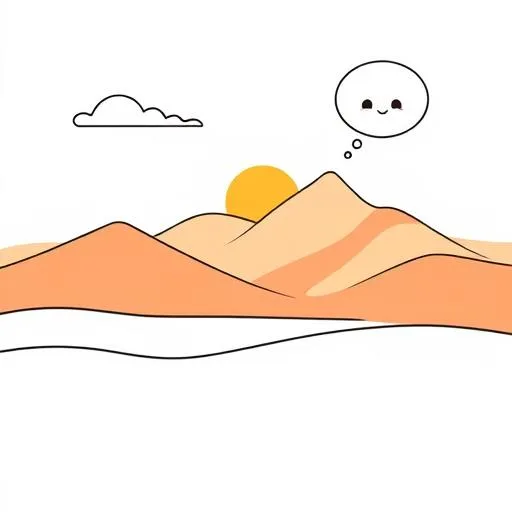
Imaginez le sourire d’un jeune de 24 ans, Matt Deitke, quand Mark Zuckerberg lui glisse qu’il est « prêt à signer pour un quart de milliard ». Pour ceux qui comptent les zéros, c’est 62,5 millions par an. C’était il y a quelques jours. Sur le terrain de l’intelligence artificielle, la bataille est devenue moins « NBA » que « jackpot planétaire » : OpenAI, Meta, Google DeepMind et Microsoft AI se renvoient des chercheurs comme des ballons dorés. Si Sam Altman déclare que « débaucher un génie à 10 millions revient à dépenser une pièce de 1 € quand on investit un milliard », les parents que nous sommes, nous, mesurons surtout l’inflation vertigineuse du rêve. Alors, comment préparer nos enfants à ce monde sans les pressurer ? Existe-t-il une recette, à l’ombre d’un cerisier d’automne, pour que nos enfants ne soient pas broyés par la machine, mais deviennent, un jour, les artisans d’un monde plus humain ? Allons-y pas à pas.
1. Des millions convoités, un cerveau rare… et des enfants qui jouent

Sérieusement, imaginez un peu la scène : Zuckerberg qui tente de débaucher Varun Mohan de chez Google avec une offre de 2,4 milliards ! Pendant ce temps, Sam Altman voit des chercheurs claquer la porte pour des bonus de 100 millions, et les doctorants des meilleures universités sont recrutés avant même d’avoir jeté leur chapeau en l’air. Vous voyez le tableau ? C’est complètement fou ! Et pourquoi toute cette agitation ? Parce qu’entraîner un grand modèle d’IA coûte des dizaines de milliards, rapporte CNBC. Du coup, quand on met autant d’argent sur la table, payer 250 millions pour le cerveau qui va piloter la machine, c’est presque une bonne affaire.
Derrière les écrans, les gosses peaufinent un château de cartes. Ils n’ont pas encore signé de contrat, mais posent déjà les bases branlantes du labyrinthe futur. Peut-on élargir cette « slim talent pool » sans transformer leur enfance en course à la performance ? Voici la piste numéro un : préserver le temps de jeu libre. C’est en bricolant une cape de papier ou en inventant la recette magique de la limonade que le cerveau enregistre des combinaisons neuronales inédites. Une phrase chante : « Super-intelligence ne veut jamais dire super-sage, encore moins super-gentil. » Mais jouer, rire, tâtonner, c’est déjà la première ligne de code d’un esprit visionnaire.
2. La chasse aux chercheurs, l’étranglement des petites écoles… et le rôle des familles
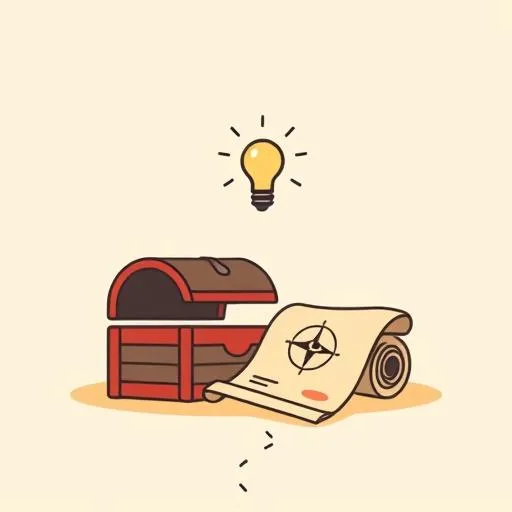
Peter Deng, ancien VP d’OpenAI, a mis en garde contre ces tentatives de recrutement agressives « qui aggravent la fracture économique ». Les laboratoires croient tellement au « super-pouvoir » de l’IA qu’ils déferlent sur les campus, moins pour enrichir la science que pour verrouiller la propriété intellectuelle. Le risque ? Concentrer l’innovation dans quelques tours de verre et laisser le champ environnant se tarir.
Que peut faire la famille ?
- Favoriser la lecture d’ouvrages accessibles pour que l’IA ne reste pas un jargon intergalactique.
- Lancer des « projets personnels » à la maison : imaginer une cabine photo en carton qui reconnaît les émotions du visage avec un vieux téléphone. Rien de sorcier quand il n’y a pas de note à la clé.
- Partager des vidéos d’un robot qui nettoie une plage. Et dire à son enfant : « Avant, les héros s’appelaient Fermi ou Oppenheimer ; aujourd’hui, ce sont Matt Deitke et Shengjia Zhao. Ils ont commencé comme toi : en étant juste curieux. » Moins de culte du secret, plus d’encyclopédies ouvertes.
3. Faire un labyrinthe autour des écrans plutôt qu’un mur

Mais au-delà de ces grands enjeux, comment on ramène ça à notre quotidien de parents ? Prenons un exemple tout simple. Imaginez une douce soirée d’été (comme on a la chance d’en avoir dans certains quartiers modernes et aérés), on prépare une glace à la pêche et on lance la discussion : « L’Intelligence Artificielle, c’est en train de devenir l’un des trucs les plus chers au monde. Mais toi, quel mot aimerais-tu rendre précieux ? » La tentation du streaming est énorme, c’est vrai. Alors pourquoi ne pas créer un « diplôme de chef de pause » pour s’amuser avec ?
Jeux à micro-dose
- Minute « pause robot » : l’ami programmé parle très vite et s’arrête net quand on prononce un mot-code choisi ensemble. Rires garantis et vocabulaire enrichi.
- Inventaire de sons : filmer le bruit de l’eau qui coule, des feuilles qui bruissent, des pas sur le sol. On montre ça à l’ordinateur pour que l’IA propose un titre musical « d’après nature ». Ensuite, on compare avec la vraie symphonie des oiseaux dehors.
- Cache-cache des compliments : un parent génère un petit poème par IA ; l’enfant devine qui est l’auteur véritable (papa ou la machine).
Le but : quand l’écran s’éteint, les sens s’allument. En évitant la spirale du « zapping sans fin », on réfléchit plus intelligemment avant que le programme ne le fasse à notre place.
4. Trois petites graines d’éthique numérique

Un : Poser la règle, avant la formule. Qui va souffrir si la machine rate son pronostic ? Encourager l’enfant à traquer les biais dans son quotidien : « Le distributeur de bonbons est-il juste avec tout le monde ? » Cette simple question ouvre la porte à une réflexion bien plus grande sur les algorithmes.
Deux : Tracer un tableau « Progrès > Propriété ». Où mets-tu la limite entre « créer ensemble » et « breveter ma cervelle » ? Ce mini-mantra simple aide à comprendre la ferveur qui fait s’échanger des millions, tout en gardant les pieds sur terre.
Trois : Relier chaque nouvelle découverte à une mission de service. « Les géants de la tech paient des fortunes parce qu’ils croient que la super-intelligence améliorera nos vies. Toi, qu’aimerais-tu soulager avec l’IA ? » L’énergie alors vient du cœur, pas du porte-monnaie.
5. Années folles, moments précieux : les compétences qui dureront
Sam Altman n’a pas menti : « Si je dépense un milliard pour un modèle, payer 10 millions pour un ingénieur est presque bon marché. » Mais la sagesse, elle, n’a pas de prix : les brevets se fanent, les modèles se démodent, et un doctorant de 24 ans sera peut-être dépassé à 26. Nos enfants, eux, garderont la propriété intellectuelle la plus rare :
- la résilience face aux bugs
- la capacité de résoudre un problème qu’on ne connaît pas encore
- l’empathie qu’aucune puce ne copiera jamais complètement
Alors, un petit clin d’œil sur le monde : au lieu de réciter « Matt Deitke, 250 millions » comme un mantra, on pourrait plutôt se dire en famille : « Matt Deitke ne dormait plus la nuit tellement il avait d’idées qui fusaient ». La curiosité, c’est ça, le vrai capital.
Source: Behind the AI talent war: Why tech giants are paying millions to top hires, CNBC, 2025/09/06
Et vous, comment faites-vous pour cultiver cette petite flamme de la curiosité chez vos enfants ?
