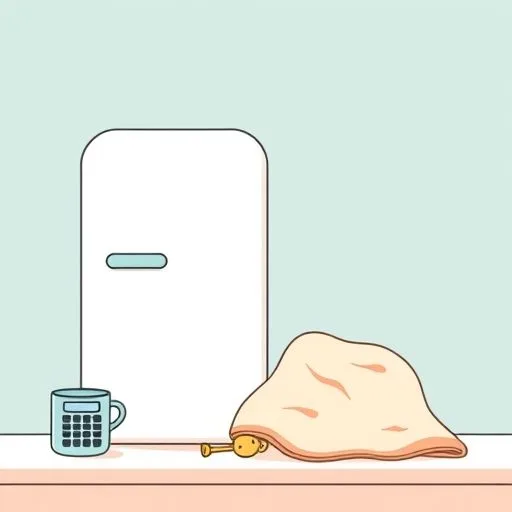
On parle souvent de l’accompagnement parental comme un équilibre délicat. Et ça me rappelle… ce jardinier que je voyais chaque matin en face, penché sur ses plants avec cette patience infinie. Pas à la manière d’André Le Nôtre domptant la nature, mais plutôt comme un observateur attentif qui sait laisser la place aux racines.
L’éducation, c’est ça: un jardin qui réclame autant d’attention que de lâcher prise.
Le tuteur invisible: soutenir sans étouffer
Vous vous rappelez? Ce moment où notre enfant a chuté en bas de la glissade? Il y a cette seconde où vous retenez votre souffle avant de décider. On ne le voit pas dans les livres ces micro-moments où notre rôle de parent bascule entre soutien et étouffement.
Avons-nous un jour mesuré nos forces à recadrer cet acte, entre la main qui se tend et celle qui lâche à temps, juste avant de s’apercevoir… qu’il l’avait déjà fait?
Comme un jardinier qui sait quel tuteur choisir, l’éducateur accompagne, trace la route mais ne tire pas sur la plante pour qu’elle pousse.
Les saisons des conflits: quand les bourgeons résistent
Les crises, comme les saisons, ont leur rythme propre. Et c’est au moment où l’on a tout préparé qu’on les voit s’épanouir différemment.
La scène, vous la connaissez, n’est-ce pas? Ces moments où notre cœur serre un peu plus… cette soirée où les règles devraient s’appliquer naturellement, devenant soudainement un terrain miné, simplement parce que l’adolescence a besoin de tester son sol.
Comme une terre, alors, qu’il faut laisser s’épuiser, avant de l’enrichir à nouveau.
Mais c’est dans ces moments-là, au creux du conflit, que la graine de leur autonomie germe, malgré la boue apparente, comme une plante qui se nourrit d’éclipses, en silence, sans que nous voyions, encore, ses racines.
Le dialogue, ces eaux douces qui irriguent lentement
Ah, ces conversations en voiture… ces espaces entre deux portes où les enfants acceptent, parfois, de laisser filtrer.
On les croit inattentifs, mais nos mots, alors, comme une eau fraîche qui coule au creux des sillons.
Et c’est là, dans ces moments de hasard et de laisser-aller, que les remarques sans jugements, les petites phrases sans attentes, agissent sans qu’aucun d’entre nous ne s’en aperçoive directement.
Je me souviens de ma fille, quand pour la première fois elle a refusé mon aide pour construire son château de sable… ce moment où j’ai compris qu’elle n’avait pas besoin de mes mains, mais juste de mon regard admiratif. Quelle joie!
Et il faut se rappeler, constamment, qu’il ne devrait pas, sans doute, y avoir de champ à l’abri, quand on l’arrose, pour qu’advienne, sans qu’on y touche, la récolte.
Le départ: quand le jardinier devient spectateur
Ce moment qui nous arrive, immanquablement… comme un doux, et pourtant violent, arrachement… On est, ce jardinier, qui a préparé le sol, surveillé, accompagné, et qui voit, maintenant, la plante sortir de son cadre.
Les vacances arrivent, la rentrée, les études: les enfants s’élancent.
Et c’est là, dans cette douce douleur, qu’on se retrouve, non pas à prier, mais à écouter, à regarder ce qui reste, à chérir ce qui a été donné, sans compter, et à se dire qu’on l’avait, bien, à quoi bon, qu’on a été, et qu’on a su, et que c’est suffisant, même si cela dépasse, et dépasse certainement, nos attentes…
L’harmonie des silences: la patience qui vient après
Alors, quand on vient les voir, quand on les attend, à la sortie des cours, ou à la fin d’une journée, il y a cette chose qui se passe, dans le silence, dans le regard, dans la manière de dire «ça va, tout va» ou «maman, c’est pas possible».
Et c’est ça, cette récolte si tardive et si douce – l’acceptation, la confiance toute simple.
Parce qu’on l’a, finalement, compris, comme le jardinier : on ne peut pas récolter chaque jour, on ne peut qu’apprendre, patiemment, à discerner, entre les lignes, ce qui nous reste, à nous, et à ce qui est à nous, de donner, encore, et encore, avec la même infinie, la même patience.
