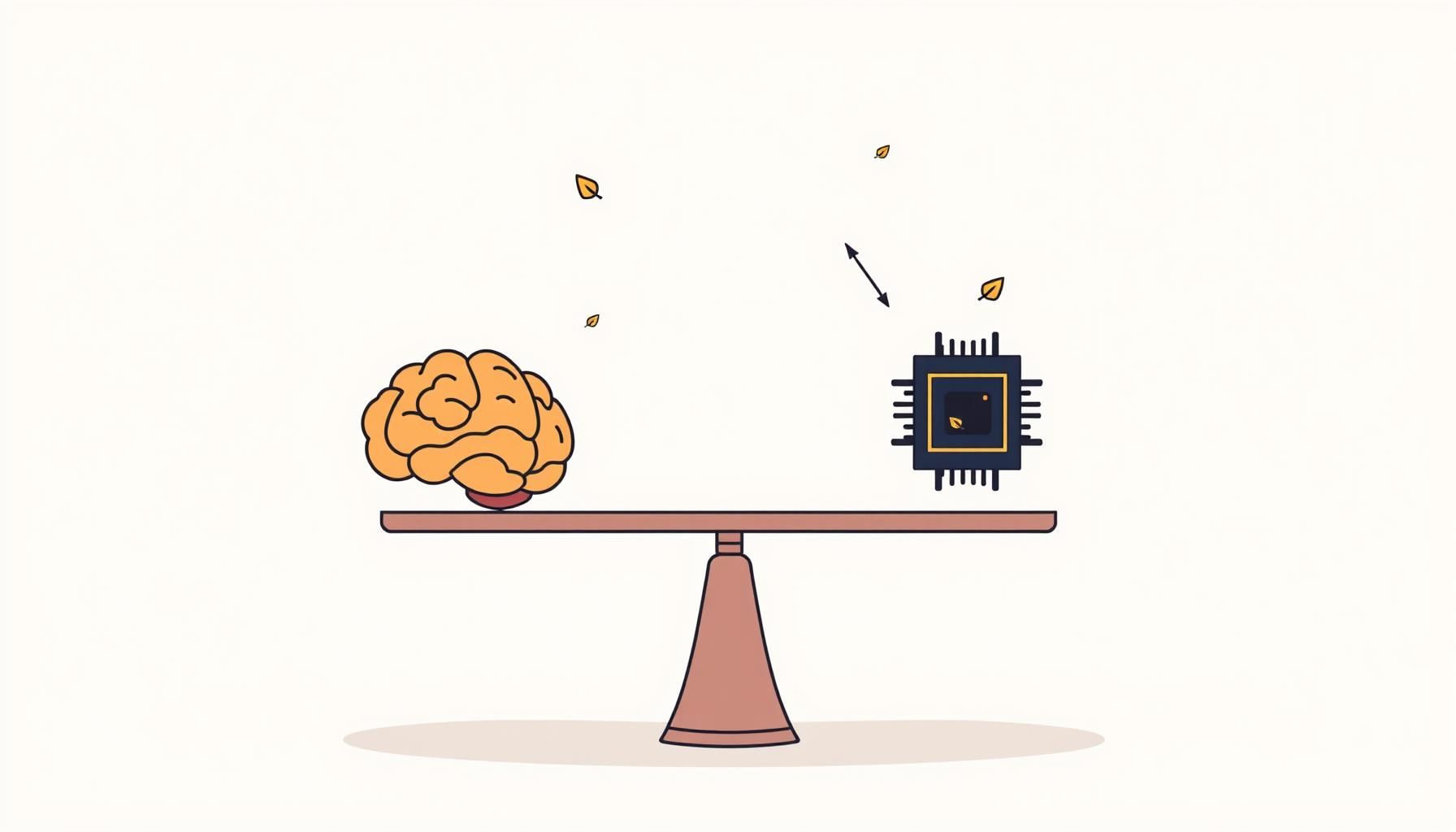
Et si la vraie menace n’était pas que nos enfants se trompent, mais qu’ils perdent l’habitude de réfléchir par eux-mêmes ? Sheri Few, figure éducative engagée, met en garde contre l’impact de l’IA sur la pensée critique à l’école. Elle souligne que des cerveaux en plein développement risquent d’être privés d’exercices essentiels si les machines répondent trop vite à leur place. Vous voyez le problème ? C’est comme si la joie de raisonner, d’argumenter, de douter – bref, de grandir – risquait de s’évaporer sous la facilité numérique.
Pourquoi Sheri Few alerte-t-elle sur l’IA à l’école ?

Sheri Few insiste : l’IA pourrait devenir une béquille trop confortable pour les élèves, surtout les plus jeunes. Elle s’inquiète d’un futur où l’on verrait apparaître des « classes GPT » dès la maternelle, privant les cerveaux en formation de l’indispensable gymnastique de la pensée. Pour construire sur cette inquiétude, il faut rappeler que d’autres chercheurs, comme Antero Garcia, partagent ce même doute face à l’omniprésence des outils numériques en classe.
Les études viennent renforcer ce constat. Une recherche publiée dans Societies explique que l’usage excessif d’outils d’IA favorise le « déchargement cognitif » : on s’appuie tellement sur la machine qu’on finit par moins exercer son propre jugement (voir l’étude). Et selon une étude du MIT Media Lab, les utilisateurs réguliers de ChatGPT montraient une baisse d’engagement cérébral et une tendance à la facilité, jusqu’à copier-coller sans réflexion (article Time). Ces résultats rappellent que la commodité technologique peut avoir un coût caché : celui de l’effort intellectuel perdu.
Comment l’IA affecte-t-elle l’esprit critique des enfants ?

Quand on observe un enfant de sept ans qui commence à poser mille questions, on mesure combien chaque « pourquoi » est une petite victoire pour son cerveau. C’est justement ce moment fragile de l’enfance que Sheri Few désigne comme le plus menacé : si l’élève délègue trop tôt ses réponses à une machine, il risque de perdre l’habitude de creuser. Le vrai défi ? C’est bien plus profond que les notes : l’esprit critique se construit dans la lenteur, l’erreur, la reformulation.
On pourrait comparer cela à une balade familiale sous une pluie d’été : prendre le parapluie facilite le trajet, mais courir sous la pluie, sentir les gouttes, improviser un jeu pour éviter les flaques… voilà ce qui forge un souvenir et un apprentissage. L’IA peut être ce parapluie pratique, mais si nos enfants ne goûtent jamais la pluie, ils manqueront d’expériences qui trempent leurs réflexes intellectuels. Un peu comme lors d’un dîner où kimchi rencontre poutine : c’est parfois ce mélange inattendu qui surprend et ouvre à de nouvelles saveurs, exactement comme les détours d’une réflexion personnelle.
Quelles solutions pour renforcer l’esprit critique à la maison ?

Plutôt que de bannir totalement la technologie, l’idée est de créer un équilibre. Quelques gestes concrets peuvent faire la différence :
- Poser des contre-questions. Quand un enfant obtient une réponse via un outil numérique, l’encourager à demander : « Comment tu le sais ? Quelles autres explications possibles ? »
- Varier les supports. Alterner entre cahiers, livres papier, discussions en famille et recherches en ligne. Cela évite que l’écran devienne la seule source de vérité.
- Inventer des micro-défis. Par exemple, transformer une sortie ordinaire en jeu d’observation : compter les formes géométriques dans l’architecture d’un bâtiment, ou deviner pourquoi certaines plantes poussent mieux après la pluie.
- Encourager l’erreur. Rappeler que se tromper fait partie de l’apprentissage. Une machine donne souvent une réponse nette ; la vie, elle, oblige à tâtonner.
Comment réconcilier IA et autonomie intellectuelle ?

L’IA en éducation n’est pas qu’une menace. Bien utilisée, elle peut stimuler la curiosité, ouvrir des horizons et offrir des ressources adaptées. Le danger, comme le notent les chercheurs, c’est l’excès de dépendance. C’est un peu comme un GPS qui nous guide partout : si l’on ne regarde jamais la route, on oublie d’orienter son propre sens de l’espace.
Les parents peuvent donc présenter l’IA comme un assistant, pas comme un cerveau de substitution. Encourager un enfant à vérifier, comparer, compléter l’information donnée par la machine, c’est l’aider à garder les rênes de sa réflexion. Et là encore, le vrai enjeu dépasse l’école : il s’agit de former des adultes capables de discernement, prudents face aux séductions de la facilité et suffisamment confiants pour choisir leur propre chemin.
Pourquoi cultiver la joie de penser avec nos enfants ?

Dans le tumulte des écrans et des outils intelligents, notre mission reste claire : montrer à nos enfants que réfléchir est une aventure exaltante. On peut transformer un dîner en petit débat amical, ou une promenade en expérience scientifique improvisée. Chaque « pourquoi » devient une graine de curiosité qui pousse différemment selon l’attention qu’on lui offre.
Sheri Few nous rappelle l’urgence de protéger l’esprit critique ; les chercheurs ajoutent des preuves tangibles des risques. Mais au fond, le plus puissant garde-fou reste notre présence active. Si nos enfants voient que penser, discuter, douter peut être joyeux, ils ne chercheront pas uniquement des réponses toutes faites. Ils apprendront que la vraie richesse, c’est le chemin de la réflexion lui-même. Et si la plus belle leçon venait justement de leurs questions imparfaites ?
Source : SHERI FEW: The AI Threat To Critical Thinking In Our Classrooms, Dailycaller, 2025-08-24 02:26:53
