
Imaginez un après-midi ensoleillé de septembre. Les feuilles commencent à sentir le changement, et l’air est juste assez frais pour sortir sans veste. Pas de pression, pas d’urgence. Juste le temps de respirer avant de repartir. Et si, sans même s’en rendre compte, nous commencions à parler comme l’IA ? Non pas en code binaire, mais en tournures de phrases, en choix de mots. Des études récentes montrent que nos langues, nos claviers, nos pensées bougent. L’IA ne se contente plus de répondre à nos questions, elle façonne aussi celles que nous posons. Quelle aventure !
Quand nos mots deviennent des modèles : comment l’IA influence-t-elle notre langage ?
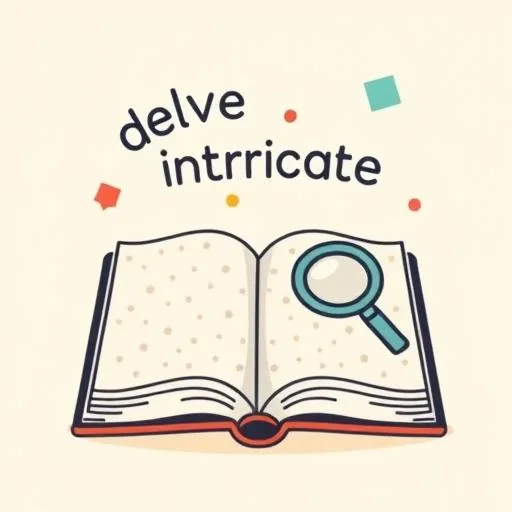
Des mots comme « delve », « underscore » ou « intricate » envahissent nos conversations, surtout dans les textes académiques ou professionnels. Ce ne sont pas des termes nouveaux en soi, mais leur utilisation accrue coïncide avec l’essor des modèles de langage génératif. Des chercheurs ont constaté que depuis l’avènement de ChatGPT, certains styles linguistiques typiques de l’IA se retrouvent de plus en plus dans les discours humains, même à l’oral.
Et ça se voit. Si vous avez déjà lu un courriel un peu « robotisé » ou entendu quelqu’un décrire une soirée « profondément enrichissante », il y a des chances que cette personne ait côtoyé un peu trop longtemps un écran avec un champ de texte ouvert.
Pour les enfants qui grandissent dans cet environnement, ces expressions peuvent vite sembler normales. Elles prennent racine dans les dissertations scolaires, les exposés, voire dans les conversations familiales. Un jour, c’est une tournure plus « savante » dans la rédaction d’une histoire. Le lendemain, c’est une manière de structurer sa pensée sans vraiment la sentir vivante.
Quand l’émotion perd un peu de son sel : l’IA affecte-t-elle notre authenticité ?
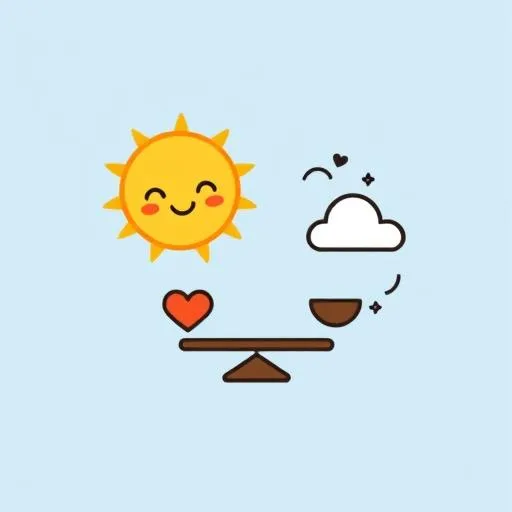
Si l’IA simplifie souvent l’accès à une expression fluide, elle n’est pas neutre émotionnellement. Une étude publiée dans Scientific Reports montre que les réponses proposées par des assistants intelligents tendent à être plus positives que la normale. Cela influence subtilement notre manière de ressentir et de formuler nos émotions.
C’est comme si on ajoutait un filtre à nos sentiments avant de les partager – un peu trop de « tout va bien » quand on n’en pense pas un mot. Pas grave pour un message rapide, mais si cela devient une habitude, l’enfant risque de confondre la surface lisse du langage avec l’intensité authentique des échanges humains.
Ce qui peut arriver, c’est qu’en imitant l’IA, on se prive d’une richesse : celle des silences, des maladresses, des larmes mal formulées. En voulant devenir plus efficaces, on devient parfois moins humains. Et ce n’est pas ce que je souhaite pour celle ou celui que vous aimez le plus – cette petite personne qui apprend encore à dire « j’ai peur » sans en avoir honte.
Pourquoi on adore ce qu’elle fait… jusqu’à l’intérieur : l’IA et la créativité des enfants

On le sait bien, hein ? L’IA nous facilite la vie. Elle rédige, corrige, inspire. Mais en douceur, sans bruit, elle renforce une certaine logique. Une qui classe, trie, optimise. Pas forcément mauvaise en soi – jusqu’à ce qu’elle imprègne nos pensées, nos jugements, nos demandes.
Pour les enfants, c’est tentant : pourquoi inventer une histoire compliquée quand l’IA vous propose une intrigue prête ? Pourquoi chercher la bonne formulation quand les suggestions clignotent sur l’écran ? Mais ce que nous transmettons, ce n’est pas juste une tâche accomplie, c’est une fascinante capacité à créer à partir de rien. Il faut y aller doucement, avec amour, et leur redire souvent : « Ce que tu écris, ce que tu penses, a une valeur bien plus grande que ce que propose une machine. »
Même si l’IA propose des milliers de chemins, il faut encore avoir le courage de marcher dans les herbes folles pour sentir autre chose que le béton digital.
Équilibrer, c’est aimer : comment préserver l’authenticité face à l’IA ?

Est-ce dramatique ? Certainement pas. Mais la conscience en est libératrice. Encourageons nos enfants à jouer avec l’IA, à la voir comme une source d’idées, oui – tout en cultivant leur voix singulière. Poser la question, c’est déjà réfléchir. Peut-être dans une pause après le goûter : « Comment veux-tu raconter ta journée aujourd’hui ? En vrai, ou en style chatbot ? »
Cette légèreté, ce sourire partagé, vaut toutes les intelligences artificielles du monde.
Pourquoi ne pas imaginer un petit jeu en famille ? C’est la personne qui emploie le mot le plus bizarre de la journée qui raconte une blague à table. Ou inventer ensemble un conte champion du monde de redondance, façon IA – puis le réécrire avec des mots plus humains.
Quelques cris doux dans ce monde connecté : réflexions sur l’IA et l’humanité
Pour moi, l’idée n’est pas de craindre ces changements, mais de les accompagner. L’IA n’est pas une menace, mais un miroir. Et ce que je vois dedans, c’est à nous d’en décider.
Chaque fois que vous écoutez votre enfant parler, essayez de repérer les traces de ces influences – et surtout, posez-vous la question : derrière le message, y a-t-il encore une chaleur ? Y a-t-il une émotion véritable ? Un moment de partage ?
Parce que ce n’est pas tant de devenir comme l’IA qu’il s’agit. C’est de rester des êtres profonds dans un monde devenu très fluide. Des êtres capables de dire « je t’aime », et de sentir chaque lettre.
Et ça, aucune machine ne l’effacera jamais.
